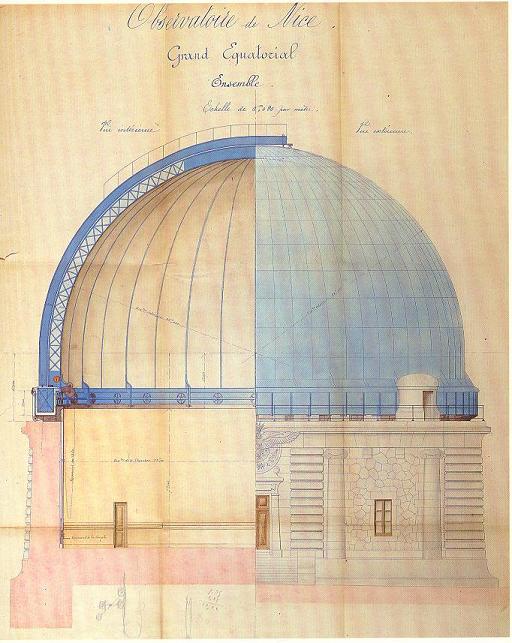LES OSSATURES MÉTALLIQUES
La coupole de l'observatoire de Nice
En 1884, intéressé par les
qualités inventives de l'industriel de Levallois-Perret,
le banquier mécène, Bischoffsheim confie à
Gustave Eiffel le soin de réaliser la coupole de
l'observatoire de Nice, mais Eiffel n'est pas seul candidat. Comment
remporte-t-il le contrat ? |
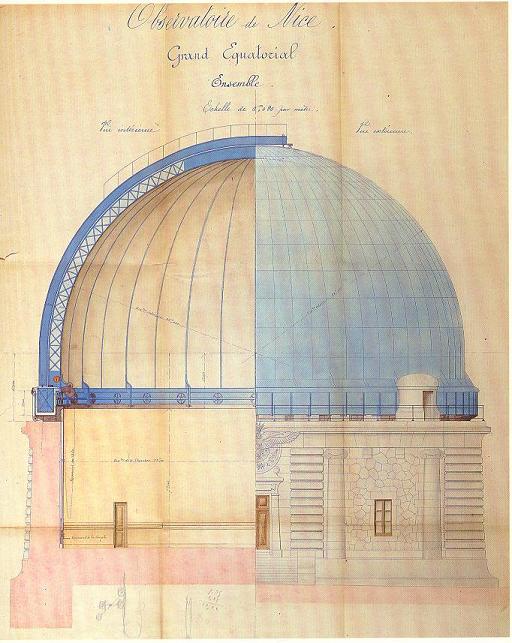
|
Tout d'abord, le 21 mai 1881, un cahier des charges est envoyé
à vingt constructeurs : sept projets sont déposés. Le projet Gustave Eiffel, jugé trop innovant, ne sera
classé que deuxième ; il retient cependant l'attention de l'Amiral
Mouchez et de l'architecte Garnier, qui s'insurgent contre la décision
de la Commission. La polémique s'aggrave puis, sur l'initiative
de l'Amiral Mouchez, le conseil de l'observatoire se prononce, le 10 février
1883, pour le projet de Gustave Eiffel. Ce dernier s'engage à garantir,
durant dix ans, le fonctionnement de la coupole.
Bischoffsheim, financier, propriétaire et maître d'ouvrages,
choisit Garnier comme architecte et confie donc à Gustave Eiffel la construction
du "grand équatorial" de 16 mètres et sa
coupole. Garnier, pour rassurer les inquiets, réintroduit dans le projet
d'Eiffel le procédé de roulement par galets, en gardant le flotteur
annulaire. Cette solution a l'avantage d'offrir un système de rechange
en cas de panne du flotteur annulaire. Le système de Gustave Eiffel est
attrayant mais pose, en effet, deux problèmes : le premier concerne l'escalier
d'observation, sur lequel se tiendra l'astronome : il doit en principe pouvoir
se déplacer sur le plancher tout en se déplaçant avec la
coupole. Escalier et coupole doivent, en effet, être liés l'un
à l'autre. Le deuxième problème concerne le poids de la
coupole : les 162 tonnes doivent être allégées mais il faut
aussi éviter le risque de déformation ; Eiffel, par conséquent,
supprime les frottements des pièces mécaniques en faisant flotter
la coupole sur la cuve annulaire. Bien entendu, cette cuve est remplie d'un
liquide approprié, le carbonate de potassium ; de ce fait, l'anneau inférieur
de la coupole devenu rigide est indéformable ; le support n'est pas sensible
aux éventuels tassements dans le mur car il est liquide. Eiffel trouve
également une autre façon d'alléger la coupole en la construisant
en acier.
Le mouvement de rotation de cette coupole est effectué
par une manivelle, mais il peut aussi être effectué par un mécanisme
d'horlogerie qui a l'avantage d' opérer un tour en cinq minutes. L'escalier
d'observation est articulé sur une plate-forme qui est montée
sur des galets, ce qui lui permet d'effectuer un cercle de 4,50 mètres
de rayon autour de la coupole. En cinq minutes, l'escalier monte depuis le sol
jusqu'au sommet. Le système d'ouverture de la coupole stupéfie
les contemporains par son modernisme : deux volets placés sur toute la
hauteur de la coupole bougent de 1,50 mètre l'un de l'autre,
laissant un espace libre de 3 mètres de largeur, sur toute
la hauteur.
GASCARD simon